Les posts de Koshi
Sommaire évolutif
- Arbres et Lean Management
- OMOTENASHI
- La page unique "Ichimai-Ka"
- Gemba Kaizen
- Confusion dans l'utilisation du mot "Gemba"
- Confusion du mot "KAIZEN et Kaizen"
- La méthode KATA
- JKK
- Paradigme de la rentabilité sur la production de grande série
- Mystérieux cadenas de Toyota 1
- Mystérieux cadenas de Toyota 2
- Méthode déductive et Méthode inductive pour Lean
- Manière de penser et de réfléchir
- Rôle des outils Lean
- Rôle des différents services lors du démarrage d'un nouveau produit ou d'une nouvelle ligne de prod
- Le Kaizen n'est pas quelque chose qui se manifeste instantanément
- Canon Production System (Naissance et Clefs de la réussite)
Arbres et Lean Management
Penser en Image et appliquer l’équation
Koshi IIYAMA
Il y a plusieurs années, j’ai eu l’honneur de participer à un projet de formation des premiers Lean Managers en France, à l’école d’ingénieurs de Lyon, sur l’invitation d’un ami. Pendant 15 ans, j’ai contribué à transmettre la culture d’amélioration continue inspirée des entreprises japonaises, tant dans la pensée que dans la pratique.
Un moment marquant fut la remise d’un plant d’olivier à chacun des sept diplômés de la première promotion, en 2008. Ce geste symbolique m’a profondément touché. Car, il illustre parfaitement une idée que je défends, c’est-à-dire, pour construire un système Lean, qu’il faut s’inspirer des lois de la nature, comme la croissance d’un arbre.
Imaginons l’entreprise comme un arbre :
- Les fruits sont les résultats et les buts atteints.
- Les branches et les feuilles symbolisent les activités et les orientations
- Le tronc symbolise les méthodes et les systèmes du Lean.
- Les racines représentent les valeurs invisibles mais essentielles : émotions, bon sens, croyances, expériences personnelles.
Cette analogie aide à illustrer le système Lean dans sa globalité. Mais pour aller plus loin, je recommande d’utiliser en même temps des équations et des lois naturelles pour comprendre réellement les mécanismes d’amélioration : Voici quelques exemples :
- Pour le Kaizen de flux logistique, imaginez une rivière ou un canal, et appliquez l’équation de la loi d’Ohm.
- Pour le Kaizen de la qualité, pensez à la fonction des pertes qualités et utilisez le « Robust design/Parameter design » comme équation.
- Pour le Kaizen des équipements, imaginez des machines autonomes et appliquez les équations de maintenance et de JIDOKA.
- Pour le Kaizen du travail manuel, imaginez un orchestre, et appliquez les équations de synchronisation et d’économie de mouvement.
Cependant, ces parties visibles d’un arbre ne suffisent pas. Sans racines solides, l’arbre ne peut survivre. De même, une entreprise sans fondations humaines et culturelles ne peut prospérer durablement.
Enfin, comme un arbre a besoin de lumière, d’eau, d’air et de nutriments, une entreprise a besoin de conditions favorables pour croître. Il faut également savoir gérer les "parasites" : problèmes, résistances, dysfonctionnements. En outre, il faut également savoir que les arbres distribuent les sucres obtenus par la photosynthèse aux racines pour favoriser leur croissance et que les fruits tombent au sol, enrichissant celui-ci grâce aux micro-organismes et aux bactéries, ce qui stimule encore davantage la croissance des arbres. Il est important de se rappeler que ces actions contribuent également à la croissance et au développement de la nature. On peut considérer que ces lois naturelles correspondent aux conditions de développement et à la raison d'être de la gestion Lean en entreprise.
Actuellement, la plupart des activités de gestion Lean que vous menez concernent probablement les parties visibles de l'arbre, ce qui peut vous causer des soucis quant aux résultats attendus et à leur durabilité.
OMOTENASHI
Koshi IIYAMA
Les manières correspondent aux règles de l’étiquette et du savoir-vivre. Le service, quant à lui, s’inscrit dans une relation asymétrique où le fournisseur répond aux attentes du récepteur, souvent dans une dynamique maître-serviteur. En revanche, l’hospitalité se distingue par sa nature volontaire et désintéressée, ne requérant aucune contrepartie.
Le concept d’« Omoténashi » incarne un esprit empreint de spiritualité et de sensibilité. Ce terme japonais peut être décomposé en « o » (préfixe honorifique) et « moténashi » (accueil ou service). Si l’on explore son sens profond, il se définit comme « témoigner du respect envers autrui, agir avec sincérité et mettre tout son cœur dans ses actions ».
Par ailleurs, « Omoténashi » est un concept unique au Japon, forgé dans le contexte de son histoire et de sa culture. Il se distingue fondamentalement des notions occidentales de manières, de service ou d’hospitalité, qui sont issues de cadres linguistiques et culturels différents. Ce qui rend « Omoténashi » si particulier, c’est qu’il repose sur une relation d’égal à égal entre celui qui offre et celui qui reçoit, basée sur un respect mutuel et une considération authentique pour les sentiments de l’autre.

La « page unique : Ichimaï-ka » est un outil incontournable dans le monde du travail
SHITSUKE (Discipline et Éducation) dans le contexte de la « page unique : Ichimaï-ka »

Création d'une page"Ichimaï-ka"
La méthode « Ichimaï-ka » vous permet de trier les informations, d'organiser vos pensées, et de les communiquer efficacement, ce qui conduit à des décisions et des jugements rapides, évitant ainsi la stagnation du travail.

4 questions et
3 étapes
1 - Déterminer le destinataire et l'objectif de la présentation
2 - Répondre aux quatre questions
- Qu’est-ce que c’est, en un mot ?
- Quels sont les points forts ?
- Pourquoi ces points sont-ils pertinents ?
- Comment mettre en œuvre ce plan ?
Ces questions sont basées sur une auto-interrogation du QUOI, POURQUOI et COMMENT
3 - Résumer les réponses sur une page unique
Gemba KAIZEN est applicable dans n’importe quel métier
Koshi IIYAMA
Un matin de juillet 2024, à 8h00, une journée passionnante de Gemba KAIZEN a débuté. Le terrain de jeu pour les étudiants du Mastère Spécialisé en Excellence Opérationnelle (MSEO) de l’INSA Rennes était l’entreprise d’exploitation de carrières « Carrières Mousset », un secteur où l'on entend rarement parler d’excellence opérationnelle. Les objectifs et les attentes de la journée avaient été clairement définis lors d'une visite préliminaire un mois plus tôt en présence du responsable du MSEO, Frédéric SORRE. Le défi du jour était de savoir si les étudiants pouvaient présenter un rapport d’analyse à 15h30 et proposer un plan d’action concret et convaincant à l’entreprise.
L’entreprise nous avait confié deux missions principales : réduire le temps que les clients passent sur le site (de l’arrivée du camion au départ) et optimiser l’aménagement des zones de stockage de gravier de différentes tailles. À 9h00, les deux groupes d’étudiants se sont mis au travail, collectant les informations et les données nécessaires pour atteindre leurs objectifs respectifs en se rendant sur le terrain.
Concernant le Gemba KAIZEN (現場改善), il existe quatre types de Kaizen :
- Kaizen d’installation (Setsubi Kaizen設備改善)
- Kaizen de qualité (Hinshitsu Kaizen品質改善)
- Kaizen de management (Management Kaizenマネジメント改善)
- Kaizen de flux : Travail (Sagyo Kaizen作業改善) et Processus (Koutei Kaizen工程改善)
Autrement dit, ces quatre types de Kaizen couvrent l’ensemble des professions. Dans ce cas précis, le Gemba KAIZEN demandé par cette entreprise était un KAIZEN de processus (Koutei Kaizen), qui doit respecter certains Genri/Gensoku (principes/règles) du système de flux. Cela signifie qu’il faut améliorer (stabiliser) chaque opération avant d’améliorer le flux : Principe de Ten, Sen, Men.
Pour optimiser le temps d’analyse, les étudiants ont reçu des conseils sur les types de Muda à observer et sur la manière de synthétiser les résultats.
À 15h30, les deux groupes ont présenté leurs plans d’action et les résultats attendus basés sur leur analyse de la situation actuelle et future. Malgré le temps limité pour l’analyse et la réflexion, les étudiants ont brillamment réussi à convaincre les salariés et les dirigeants de l’entreprise. Je félicite leur travail de qualité en tant qu’accompagnateur. Cependant, d’un point de vue professionnel, je pense qu’il était crucial de consolider davantage les principes de chaque objectif d’amélioration.
Par exemple, pour le groupe travaillant sur l’optimisation des emplacements des stocks, il aurait été pertinent de souligner que les stocks sont un mal nécessaire pour l’entreprise, tout en optimisant l’aménagement demandé. C’est-à-dire que le groupe devrait proposer également l’amélioration du chargement direct (15%) pour but de diminuer l’utilisation des stocks (85%). Quant au groupe travaillant sur la réduction du temps de présence, il était essentiel de prendre en compte le principe du « Takt time », qui synchronise tous les processus sur le site. Souvent, le manque de synchronisation entre les processus est la principale cause de l’allongement du temps de flux, et cette synchronisation pourrait transformer l’organisation du travail de manière significative.
En dernier lieu, lorsqu’on recherche des améliorations, je conseille de penser toujours aux types de KAIZEN et à leurs « Genri/Gensoku : Principes/Règles » de manière déductive* pour déterminer la direction à suivre, que ce soit scientifiquement ou rationnellement.
Cf : *Post : Méthode déductive vs Méthode inductive pour Lean

Confusion dans l’utilisation du mot « Gemba »
Koshi IIYAMA
Le mot « Gemba » est employé de façon naturelle par tous les experts du Lean. Toutefois, il me semble aujourd’hui qu’il y a une confusion au moment de leur utilisation. Car le mot « Gemba » a une différence de sens quand on l’utilise seul et quand on l’utilise dans les expressions de « Gemba, Genbutsu » et de « Gemba, Genbutsu, Genjitsu ». Voici une explication succincte de ces mots et de leurs sens d’utilisation d’origine.
Tout d’abord, rappelez-vous que le mot Gemba (Fr) ou Genba (Jpn) signifie « un lieu ou un terrain d’action et de phénomène » et qu’il se combine avec d’autres noms pour devenir un nom propre. Par exemple : Gemba Kaizen®, Gemba Walk, Gemba Kensho (Vérification sur place), etc…
En ce qui concerne l’expression en 2 mots « Gemba, Genbutsu », elle a été probablement déformée à partir du terme d’origine « Genchi, Genbutsu », car l’expressions « Gemba, Genbutsu » n’est pas l’expression usuelle au Japon. Cette expression étrange serait née, sans doute, par le terme « Gemba, Genbutsu, Genjitsu » qui est déployé traditionnellement en tant que les 3 réels (Sangenshugui) dans un milieu des industries professionnelles.
Personnellement, il serait souhaitable que l’expression « Gemba, Genbutsu » soit remplacée avec « Genchi, Genbutsu » comme un nom propre d’origine. Et cette expression en 2 mots signifie l’importance de « voir le produit réel sur le terrain, d’évaluer l’essence des choses, de se mettre rapidement d’accord, de prendre des décisions et de les exécuter de toutes nos forces ». Ce terme continue d’être utilisé pour désigner la « méthode TOYOTA », qui précise les valeurs et les lignes directrices d’action que Toyota devrait partager en tant qu’employés.
Quant au principe de trois réels : « Gemba, Genbutsu, Genjitsu » ou « Genchi*, Genbutsu, Gennin** », c’est l’idée que « lieu réel, objet réel et fait réel » sont importants pour la recherche des causes et des solutions, et que cette application est la force motrice du résultat de l’entreprise. Il est connu comme la philosophie de base de Honda, qui a été mise en avant par le fondateur M. Soichiro HONDA (1906 ~ 1991). De plus, le principe de « Gemba, Genbutsu, Genjitsu » a été adapté dans toutes les entreprises japonaises, même chez TOYOTA
En résumé, quand vous parlez des valeurs et des directives d’action, il vaut mieux dire « Genchi, Genbutsu » si vous voulez respecter l’usage d’origine et quand on parle du principe de 3 réels (Sangenshugui), il vaut mieux dire « Gemba, Genbutsu, Genjitsu » ou « Genchi*, Genbutsu, Gennin** ».
Genchi *: lieu, local, Gennin **: constat, observation
Confusion entre « KAIZEN® » et Kaizen
Koshi IIYAMA
Le mot « Kaizen » s’est fait connaître en Europe et aux États-Unis grâce au livre de Masaaki Imai (1930~2023) « KAIZEN ® : The Key to Japan’s Competitive Success ». Le mot KAIZEN® se traduit par le mot anglais « Continuous Improvement » et explique comment s’est transformé « 改 : kai » en un bon « 善 : zen ».
Cependant le mot kaizen est utilisé différemment dans la vie quotidienne au Japon. Parce que ce mot est utilisé non seulement pour l’amélioration du lieu de travail, mais aussi pour la vie sociale, personnelle et familiale. En fait, le mot kaizen pour le Japon signifie « rendre les choses meilleures qu’elles ne le sont maintenant » dans le sens de créer de la joie et de la satisfaction pour les parties impliquées et les choses. Le mot « Zen) signifie également la joie (喜び : Yorokobi). Pour votre curiosité, l’opposé du mot kaizen est « Kaiaku : 改悪 » détérioration.
En plus, pour comble de confusion, le mot « kaizen » ne peut pas être utilisé selon le thème de l’amélioration. C’est parce qu’il existe un synonyme de kaizen, « kairyo : amélioration », qui est utilisé à la place de « kaizen ». Ces deux mots ont la même signification, mais utilisés de manière différente selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Par exemple, « kairyo » est utilisé dans des situations où il cible une chose spécifique : l’amélioration du moteur, l’amélioration du terreau, l’amélioration de la race, l’amélioration du médicament, etc. À l’inverse, « kaizen » est plus susceptible d’être utilisé dans des situations où les choses abstraites : l’amélioration des conditions et des méthodes de travail, l’amélioration du temps d’attente, l’amélioration des relations humaines, etc.
En conclusion, le mot « Kaizen » que nous utilisons en Europe et aux États-Unis est un usage dans le cadre d’une méthodologie d’amélioration « KAIZEN® », mais le mot littéraire « kaizen » est utilisé dans des situations où les choses abstraites. Ensuite, dans des situations qui ciblent des choses spécifiques, les japonais utilisent un autre mot « Kairyo » à la place de “Kaizen”.
Est-ce Kaizen ou Kairyo ? Testez votre compréhension :
1) « Nous avons amélioré le moteur pour qu’il puisse fournir le plus de puissance. »
2) « Méthodes de vente améliorées »
3) « Amélioration du flux de production »
4) « Amélioration du coût de productivité »
5) « Amélioration du goût du whisky »
Réponses : 1: Kairyo, 2: Kaizen, 3: Kaizen, 4: Kaizen, 5: Kairyo
La méthode KATA
Koshi IIYAMA
Le terme japonais « kata » est de plus en plus souvent mentionné dans le contexte du système du LEAN management. Cette popularité semble être en grande partie influencée par le livre de Mike Rother, Toyota Kata, publié en 2009. Cependant, le mot « kata » est également bien connu dans des disciplines comme le judo ou le kyudo, qui sont appréciées en France. Dans les arts martiaux et les arts du spectacle traditionnels japonais, les mouvements et processus codifiés sont appelés « kata », et l’entraînement à ces pratiques suit une méthodologie appelée « SHU, HA, RI », que j'ai d’ailleurs expliquée dans un précédent post sur LinkedIn.
On peut ainsi dire que la méthode KATA de Toyota est une adaptation de ces concepts de « kata » et de « SHU, HA, RI ».
Dans le cadre de l’introduction du Lean management, la première étape consiste à apprendre le KATA. Tant que vous ne le maîtrisez pas, vous devez suivre rigoureusement les étapes prescrites, sans y ajouter vos propres variations. Une fois la maîtrise acquise, vous pouvez commencer à y ajouter votre touche personnelle. À ce stade, vous êtes en mesure de créer votre propre kata, basé sur vos expériences. On dit que l'acquisition du kata est une première étape essentielle pour développer des compétences et des connaissances fondamentales. Ce n’est qu’ensuite, en y ajoutant autonomie et réflexion personnelle, que l’on parvient à la véritable créativité.
Une autonomie sans fondement solide en compétences et connaissances peut souvent conduire à la confusion et à l’individualisme excessif. Par conséquent, avant de chercher une véritable autonomie, il est crucial de maîtriser d'abord le « kata ».
Les fondamentaux JKK (Ji-kotei-Kanketsu) ne sont pas correctement mis en œuvre
Koshi IIYAMA
Lorsque j’étais directeur de quatre sites de production, j’entendais souvent les chefs de service se demander comment transmettre efficacement les instructions de travail à leurs équipes et superviser leur exécution. En effet, de nombreuses tâches étaient fréquemment reprises ou corrigées, ce qui entraînait des pertes de temps et une diminution de l’efficacité. Dans ce post, je partage avec vous une contre-mesure particulièrement efficace que nous avons mise en place. Cette approche s’applique non seulement aux sites de production, mais aussi aux bureaux et à tous types d’environnements de travail.
Voici quelques exemples de problèmes rencontrés :
- Un chef de service souhaitait présenter les résultats des améliorations au directeur général. Il a donc demandé à son équipe de préparer le rapport d’amélioration. Cependant, les rapports reçus étaient si détaillés qu’ils en devenaient difficiles à interpréter pour le directeur, qui a dû redemander une version simplifiée.
- Un chef de production a demandé si la productivité de chaque produit était bien mentionnée séparément dans le rapport qu’il avait demandé. Son subordonné a répondu : « Désolé, je ne l’ai pas inclus, je vais m'en charger immédiatement. »
- Lors d’une réunion d’amélioration, une grande salle de conférence était nécessaire en raison du nombre de participants. Le subordonné chargé de la réservation avait cependant oublié de bloquer la grande salle, entraînant un désagrément pour toute l’équipe.
Ces types de problèmes sont courants et ne sont pas seulement causés par les subordonnés, mais aussi par leurs managers. La cause de ces erreurs est basée sur l’une des six raisons suivantes :
- Absence d’un but commun pour le travail.
- Absence d’une vision claire de l’« image finale » du travail attendu.
- Manque de partage de la « procédure » spécifique pour le travail.
- Absence de consensus sur le niveau de qualité ou le « niveau acceptable » du travail attendu.
- Informations incomplètes fournies pour accomplir correctement le travail demandé.
- Non-compréhension de la « raison d’être » des procédures et des règles, ce qui conduit certains à prendre des décisions individuelles sans cadre clair.
Ces éléments sont essentiels pour assurer le bon déroulement du travail. Réviser ou reprendre le travail entraîne un gaspillage de ressources considérable, ou « Muda » dans le vocabulaire Lean. Cela s’inscrit dans le concept de « Jikotei Kanketsu » (JKK) de Toyota, qui vise à garantir que chaque tâche soit réalisée correctement dès la première fois, sans besoin de reprise, et que seuls des produits de qualité soient fabriqués, éliminant ainsi les corrections ultérieures et les contrôles finaux. L'adoption de ce concept s'est révélée être la solution la plus efficace dans notre cas.
Paradigme de la meilleure rentabilité avec une grande quantité.
Nouvel indicateur de la profitabilité Koshi IIYAMA
La réduction des coûts et la réduction du délai peuvent également être comparées en termes de « Vente ou production en grande quantité à faible prix » et « Vente ou production en rotation rapide des stocks à faible prix ». A ma connaissance, en cas de petit profit, vous perdrez si vous appliquez « la méthode de la vente ou de la production en grande quantité », et vous réussirez si vous appliquez « la rotation rapide des stocks ». Voici une histoire réelle :
Une entreprise de grande distribution, qui était célèbre pour sa vente en grande quantité à faible marge, aurait utilisé l’argent des ventes de la veille pour approvisionner les marchandises tous les matins lors de la période de fondation de l’entreprise. Et au fur et à mesure qu’elle s’est élargie, et que les fonds devenaient de plus en plus importants, elle a déployé sa stratégie d’augmentation du lot d’achat et l’a utilisée comme moyen pour réduire le prix d’achat. Toutefois, en fin de compte, quand sa dette a égalé le montant des ventes annuelles, elle a fait faillite.
Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Quand vous déployez le Lean, pour répondre à ce problème de grande quantité, vous pouvez l’expliquer d’un point de vue organisationnel, mais vous avez quelques difficultés à l’expliquer d’un point de vue économique.
Il y a une dizaine d’années, j’ai proposé, à l’association Master Lean de mes anciens élèves de l’ECAM de Lyon de tester un nouvel indicateur de profitabilité pour convaincre leur contrôleur de gestion de l’entreprise, ce qui est, parfois, l’un des obstacles du déploiement du Lean. Mais cette résistance du contrôleur de gestion* est tout à fait normale, car jusqu’à présent, il n’y avait pas d’indicateurs simple pour expliquer économiquement ce paradigme sur l’achat ou la production en grande quantité.
Cet indicateur non explicité existe déjà dans l’esprit de chacun, mais pas sous une formule mathématique. Par exemple, imaginez que vous avez acheté deux appareils photo à 300€ chacun pour les revendre plus cher. Et vous les avez revendus à 340€ chacun.
Du point de vue du bénéfice, ces deux ventes sont identiques, mais concernant leur profitabilité, ce n’est pas la même chose. Car l’un a été vendu au bout de 3 mois, l’autre au bout d’1 an par exemple. Cette différence de délai d’attente doit être considérée dans le calcul de la profitabilité réelle. Il était donc nécessaire de créer un nouvel indicateur de profitabilité* pour répondre à cette question du délai. Ci-après, vous trouverez la formule du nouvel indicateur de profitabilité en question : (cet indicateur peut être libellé à votre convenance car il n’existe pas officiellement : Indice de profitabilité en temps par exemple)
Indice de profitabilité en temps = Bénéfice / Coût / Délai.
Pour la question des appareils-photo, l’un est calculé comme suit : 40€/300€/3mois soit 0,04/mois, et l’autre est 40€/300€/12 mois soit 0,01/mois. De ce fait, vous pouvez comprendre grâce cette indice, que le premier appareil-photo est 4 fois plus profitable que le 2ème appareil photo.
Ce nouvel indice de profitabilité en temps est applicable pour l’histoire du grand distributeur que j’ai racontée au début.
Indice de profitabilité en temps = Bénéfice / Montant de l’achat / délai = (bénéfice / montant d’achat) × (1 / délai),
Si on estime que le % de bénéfice était de 10%, c’est-à-dire, « bénéfice / montant d’achat » = « marge brute » est de 0,1, il sera donc calculé comme suit.
Lors de la fondation de l’entreprise : Indice de Profitabilité en temps = 0,1 / Délai = 0,1/3 jours** =0,033/jour
soit 12,05/an (= 365 x 0.033) (3 jours** voir ci-après)
Au moment de la faillite : Indice de Profitabilité en temps = 0,1/365 jours =0,000274/jour
soit 0,1/an (= 365 x 0,000274)
C’est-à-dire que l’indice de profitabilité en temps au démarrage de l’entreprise était 120 fois plus important que lors de la faillite.
Quand ce distributeur a utilisé l’argent de la vente de la veille pour aller acheter les marchandises tous les matins, les produits ont été renouvelés tous les 3 jours. Toutefois, lorsqu’il a commencé à le remplacer qu’une fois par an d’achat, vous pouvez comprendre comment la profitabilité a changé même si la marge brute était identique. En conclusion, la réduction du délai est très importante pour vos projets Lean.
Lorsque cette entreprise a été fondée, elle était en fait basée sur un « Petit profit en rotation de stock rapide », mais ensuite, elle s’est transformée en un « petit profit en grande quantité de vente ». On peut dire qu’elle a été détruite parce qu’elle a procédé à la réduction des coûts par achat en grande quantité et a ignoré le raccourcissement du délai. Cet exemple est applicable bien sûr pour les entreprises de production qui font une grande taille de lot de production pour baisser le coût qui est justifié partiellement.
J’espère que ce nouvel indicateur permettra aux managers de prendre une bonne décision pour mieux organiser le travail.
**: Pour le contrôleur de gestion, la VAN (Valeur Actualisée Nette) est utilisée pour évaluer le retour sur investissement et le résultat de la simulation confirme la même conclusion que ce nouvel indicateur. (Infos de N.JOFFRION)
À la découverte des clés d’un mystérieux cadenas Toyota -1ère partie
Koshi IIYAMA
Beaucoup affirment que les clés de la réussite de cette entreprise résident dans la "visualisation" et les outils du système de production (TPS), ainsi que dans sa "puissance commerciale" et sa "solidité de l'approvisionnement". Pourtant, malgré toutes les tentatives pour imiter ces pratiques, pourquoi ne parvenons-nous pas à obtenir des résultats comparables ? Ce mystère intrigue. En y regardant de plus près, il devient clair que le secret réside non seulement dans les ressources humaines, mais aussi dans les comportements et la mentalité des employés, façonnés par une formation interne spécifique.
Dans le monde du sport, les équipes traditionnellement fortes continuent de gagner, car elles disposent de méthodes d’entraînement dit traditionnelles qui développent la force collective, les compétences individuelles et la force mentale.
Alors, quel est le modèle de formation (y compris OJT : On the Job Training) traditionnel des employés dans cette entreprise ? Une réponse se trouve dans une habitude instaurée depuis les années 70 : la « tradition » de rédiger tous types de documents et rapports sur une seule feuille particulier.
À cette époque, des enjeux majeurs, comme les chocs pétroliers et la pollution due aux émissions, exigeaient une réflexion collective rapide et une compréhension partagée au sein de l'entreprise. Chaque employé était encouragé à étudier les problèmes, à en extraire les points essentiels et à les présenter lors de réunions ou de séances de formation, permettant aux autres d'apprendre et de tirer des enseignements. C'est ainsi qu'est née l'utilisation du format A3, conçu pour résumer les informations essentielles sur une seule page. (A3 n’était pas à l’origine destiné à résoudre des problèmes)
Aujourd’hui, cette méthode perdure avec une règle : limiter tous les documents de travail (rapports, propositions, convocations de réunions, documents de décision, évaluations, etc.) à une seule feuille de papier au format A3 ou A4. Cette concision oblige chacun à clarifier ses idées et à se concentrer sur l’essentiel, favorisant ainsi l'efficacité et une compréhension partagée.
L'habitude et la capacité de rédiger les informations sur un seul feuillet constituent l'une des clés de leur réussite, un aspect que d'autres entreprises n'ont pas su intégrer. Ces documents, bien que variés, partagent des caractéristiques communes qui en font de puissants leviers d’amélioration continue. Dans mon prochain article, j’aborderai les points communs de ces feuillets d’une page. A suivre...
À la découverte des clés d’un mystérieux cadenas Toyota - 2ème partie
Ichimaï-ka Koshi IIYAMA
Une exploration de la clé oubliée :
La « visualisation : Miëru-ka » est un principe emblématique de Toyota, permettant à chacun de comprendre instantanément une situation et de déterminer si elle est « normale » ou « anormale », afin d’agir rapidement en conséquence.
Mais cette idée ne se limite pas aux processus physiques : elle s’étend également à la structuration des idées et des réflexions des employés, matérialisées par une seule feuille de papier, souvent au format A3.
Ainsi, Il n’est pas exagéré de dire que le travail de cette entreprise repose toujours sur cette « page unique », qui marque à la fois le début et la fin de chaque démarche.
À quoi ressemble cette fameuse « page unique » ?
Les documents, essentiel chez Toyota, sont structurés en principe, autour de cinq thèmes récurrents
1 - Objectif / 2 - Situation actuelle / 3 -Enjeux / 4 - Contre-Mesures / 5 -Calendrier
En réfléchissant et en organisant le travail selon ces perspectives, les employés parviennent à transmettre leurs idées clairement, que ce soit dans des procès-verbaux, des propositions ou des rapports. Cette structure facilite la compréhension par les supérieurs et les collègues, garantissant ainsi que le travail progresse de manière fluide et collaborative.
Les trois caractéristiques communes des feuilles d’une page :
Selon un écrivant ayant travaillé au sein de l’entreprise Toyota, ces « pages uniques » partagent trois caractéristiques essentielles :
- Une vue d’ensemble sur une seule page : tout est accessible en un coup d’œil, sans avoir besoin de feuilleter plusieurs pages.
- Une case dédiée : la zone clairement délimitée par ligne incite instinctivement à remplir les espaces vides, une habitude naturelle chez les humains.
- Un thème donné pour chaque case : cela facilite la collecte d’informations et retient l’attention du lecteur.
Un outil conçu pour la prise de décision rapide :
Cette fiche n’est pas seulement un exercice de concision, mais une réponse à des besoins concrets d’efficacité. M. Akio Toyoda, PDG de TOYOTA, avait une règle simple : un rapport doit permettre de prendre une décision en quelques secondes. Cela impose au rédacteur de produire une page réfléchie, claire et concise, capable de transmettre toutes les informations nécessaires sans superflu.
Une méthode qui transcende la simplicité :
Les avantages de cette pratique sont multiples : les points essentiels sont mis en avant, les informations superflues sont écartées, et le temps consacré aux réunions est considérablement réduit. En outre, cette méthode constitue un outil de formation efficace pour les nouveaux employés, les initiant dès le départ à une culture de clarté et de concision.
En conclusion, la capacité à trier et réorganiser les informations (SEIRI, SEITON), à résumer les idées et à les transmettre efficacement découle naturellement de cette tradition de la « page unique : Ichimaï-Ka ». Ce processus, devenu une véritable coutume, incarne l’une clé d’un mystérieux cadenas TOYOTA, qui contribue à son succès durable.
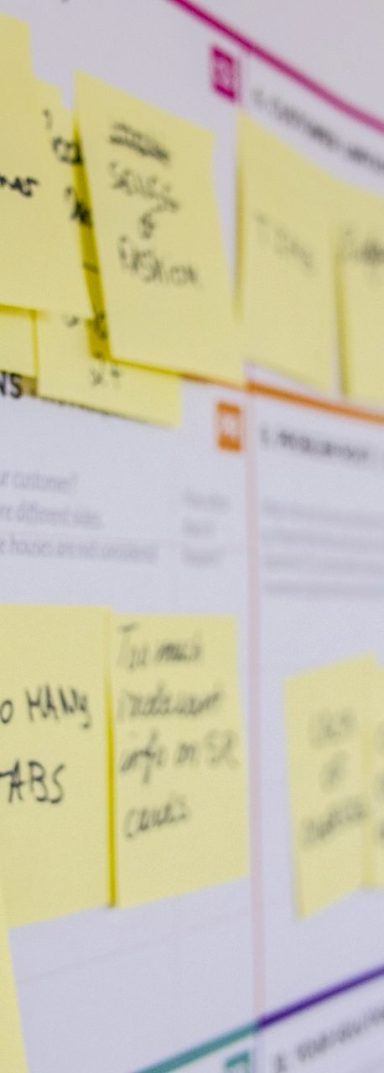
Méthode déductive vs Méthode inductive pour Lean
Koshi IIYAMA
Selon Shingo SHIGEO (1909-1990, Inventeur de la méthode SMED), l’homme aurait d’abord découvert la méthode déductive, selon laquelle un principe est d’abord posé, et ensuite sont présentés des exemples spécifiques.
Par exemple, on pose un principe, disons « le Muda est un moyen (ou Fonction) excessif ou inutile pour atteindre un but ». Et ensuite, on l’explique en termes concrets : “utiliser un marteau pour casser un œuf est un Muda." "Un stock de défauts s’accumule à la sortie du contrôle est également un Muda "
Puis une autre méthode, la méthode inductive qui aurait été développée quelques centaines d'années plus tard.
Elle consiste d’abord à présenter plusieurs exemples banaux, des faits concrets (Phase observation) et dans un second temps, à examiner les données en détail (Phase de la reconnaissance des formes). Enfin, on conclut avec un principe qui relie ces faits entre eux. (Phase de développement du principe). Cette méthode serait plus efficace pour convaincre les interlocuteurs d’après Shingo.
Par exemple, on peut illustrer avec ces deux exemples suivants :
- Quand vous achetez des huitres, il vous est loisir de remarquer qu’une partie de ce que vous payez n’est autre que de la coquille non comestible.
- En sortant des toilettes, ne serait-il pas une erreur, en termes d’hygiène, de se laver les mains après avoir remis en ordre ses vêtements.
Le principe général est expliqué après coup : à l’occasion de nombreux actes de la vie quotidienne, nous n’avons pas conscience de la présence de Muda. C’est justement une explication inductive.
Shingo SHIGEO avait souvent expliqué les choses de manière inductive.
Quelle méthode utilisez-vous pour enseigner les principes de Lean?

Manière de penser et de réfléchir :
3S (Seiri, Seiton, Seisou) et 4 types de relation
Koshi IIYAMA
Je suis persuadé que ceux qui sont efficaces et excellents dans le travail ou dans la recherche de solutions, ont la capacité d’identifier les utiles parmi des infos ou des données obtenues (Seiri), qu’ils sont ensuite capables de les classer selon le type de relation entre elles (Seiton) et de visualiser la situation et les problèmes (Seisou)
Concernant le type de relation, il est connu qu’il n’y en a que 4. Bien que le monde contienne des milliards et des milliards de gens, d’objets et d’affaires et on pourrait penser qu'il y a une infinité de variétés de relations qui existent entre ces gens, ces choses et ces affaires. Pourtant, s’il existe une relation entre les éléments, elle peut être classée selon l’un des quatre types de relation. Ce sont :
- La relation de Cause-Effet : l’incendie et un mégot de cigarette allumé ou les parents et l’enfant…
- La relation d’Opposition : la chaleur et le froid ou le mâle et la femelle…
- La relation de Similitude : le couteau en inox et le couteau en céramique ou le frère et la sœur …
- La relation de Proximité : le téléviseur et la télécommande, ou l’ami et l’ami…
En gardant à l’esprit ces 4 types de relations, vous pouvez analyser toute une variété de phénomènes (problèmes) et soulever une foule de questions importantes pour trouver des solutions. Par exemple,
(La relation cause-effet) N’y a-t-il pas quelque chose qui provoque le phénomène considéré ? (La relation d’opposition) N’y a-t-il pas quelque chose qui s’oppose à lui ?
(La relation de similitude) N’y a-t-il pas quelque chose qui lui ressemble ?
(La relation de proximité) N’y a-t-il pas quelque chose qui apparaît toujours en conjonction avec cet élément ?
Cette manière de penser et de réfléchir sera d’un grand secours pour trouver des solutions à vos divers problèmes de votre métier, qu’importe son domaine.
A votre tour de tester cette méthode.

Rôle des outils Lean
Koshi IIYAMA
Imaginez que vous avez très faim. La première chose que vous faites normalement est de chercher quelque chose à manger chez vous, n’est-ce pas ? Mais quelle serait votre réaction si vous ne trouviez rien ? Vous pourriez abandonner, commander la livraison, aller au restaurant, ou décider de préparer quelque chose vous-même. Il va sans dire que votre choix dépendrait de l’environnement et des conditions dans lesquelles vous vous trouvez (physiques, mentales, compétences, situation économique, temps disponible, etc.).
Ces réactions sont similaires lorsque vous êtes confronté à un problème. Si vous décidez de le résoudre, les outils Lean deviennent utiles, tout comme une recette de cuisine. Cependant, le résultat (le goût) ne serait pas garanti à 100 % de répondre à vos attentes, car cela dépend du choix de la recette et des compétences du cuisinier. Dans tous les cas, vous n’aurez plus faim.
Les outils Lean fonctionnent de la même manière. Ils sont comme des recettes qui vous guident pour résoudre les problèmes de manière efficace. Tout comme en cuisine, la maîtrise des outils Lean nécessite de la pratique et de l’expérience pour atteindre des résultats optimaux. Une bonne utilisation des outils Lean peut non seulement résoudre les problèmes, mais aussi améliorer continuellement les processus, créant ainsi une organisation plus agile et efficace.
Cf : LA BOITE À OUTILS du Lean (DUNOD)
Rôle des différents services lors du démarrage d’un nouveau produit ou d’une nouvelle ligne de production
Koshi IIYAMA
Service Qualité
Le Service Qualité joue un rôle central en validant chaque étape du processus de démarrage :
- Développement du produit → Essai de production → Production en série
À chaque phase, une évaluation est réalisée à l’aide de chiffres codifiés en fonction de la gravité des problèmes qualité. Si l’évaluation ne répond pas aux critères requis, l’avancement à l’étape suivante est bloqué.
Ce service définit également les sujets de contrôle, la fréquence des vérifications ainsi que les critères de validation du contenant, du contenu et du conditionnement des expéditions.
Service Gestion du Coût
Ce service vérifie si le coût de production est conforme aux objectifs financiers définis. Le respect du budget est une condition essentielle pour poursuivre le projet, au même titre que la validation qualité.
Service Technique Industriel
- Rédige les cahiers des charges pour la nouvelle ligne de production.
- Prend contact avec les fournisseurs afin d’obtenir des devis. Si un devis dépasse le budget prévu, une étude est menée pour optimiser les coûts avant de valider la commande.
- Supervise l’ensemble des travaux et s’assure du respect des conditions de réception des équipements.
Exemple de critère de réception des équipements :
- Le taux de performance machine doit être supérieur à 98% sur 2 heures de fonctionnement.
- Aucune anomalie de qualité produit ne doit être détectée.
Ce service détermine également le calendrier de maintenance des machines (vérification du fonctionnement, contrôle de l’usure et resserrage des équipements).
Service Technique Produit
- Établit les conditions nécessaires à la stabilisation de la production en série.
- Lors des essais de production, il vérifie si le produit répond aux exigences industrielles.
- Conçoit des témoins de limite pour faciliter le contrôle qualité.
- Prépare les conditions optimales avant le lancement de la production en série.
Service Planification
- Assure la disponibilité des matières premières pour les essais.
- Élabore le programme de production en coordination avec le service commercial.
Service Production
- Vérifie la conformité des conditions de production définies par les autres services.
- Établit les fiches de travail standard et le plan de formation du personnel avant le démarrage de la production en série.
- Améliore l’accoutumance des opérateurs aux nouvelles procédures.
- Gère les commandes des matières auxiliaires nécessaires (feutre, scotch, cutter, gants, lunettes, etc.).
Service Environnement
- Contrôle la sécurité et le respect des normes environnementales.
- Analyse divers éléments : contenant, étiquette, emballage, palette, graisses machines, produits de nettoyage, etc.
Conseils pour le bon déroulement du processus
Résolution rapide des problèmes qualité
- Réunion du matin :
- Analyse des problèmes détectés la veille.
- Présentation du plan d’action du jour (pilotée par le Service Qualité, avec des données chiffrées).
- Réunion du soir :
- Bilan des problèmes rencontrés dans la journée.
- Évaluation de l’efficacité des actions mises en place.
- Présence du service Développement Produit : pour une meilleure réactivité sur les ajustements nécessaires.
- Analyse rapide des arrêts de ligne : pour identifier les causes et apporter des solutions immédiates.
- Présence des fournisseurs d’équipements : afin d’assurer une réactivité en cas de besoin d’adaptation des machines.
Rôle du Responsable de Ligne
Objectifs détaillés sur 2 mois
Le responsable de ligne définit les objectifs en fonction de trois axes : Qualité (Q), Coût (C), Délai (D).
- Q – Qualité :
- Stabilisation rapide du démarrage.
- Amélioration de l’ergonomie et des méthodes de travail dès l’essai de production.
- Mise en place de mesures préventives contre les erreurs humaines dans les fiches de travail standard.
- D – Délai :
- Respect des quantités demandées par les clients.
- Suivi rigoureux du planning de formation du personnel.
- Sensibilisation des opérateurs à l’importance de la qualité via un partage des problématiques et une participation active à leur résolution.
- C – Coût :
- Suivi des indicateurs de rendement, en s’alignant sur les performances des produits existants.
Points de vigilance
- Seul le responsable de ligne est habilité à faire les demandes de personnel afin d’éviter toute confusion.
- Lors des essais de production :
- Supprimer un maximum de dysfonctionnements.
- Rendre les opérateurs autonomes en répétant les opérations normales et les interventions sur dysfonctionnements.
- Noter et numéroter tous les problèmes détectés.
- Ne pas hésiter à arrêter la ligne pour analyser un problème en profondeur.
- Répéter les tâches jusqu’à ce que les opérateurs les mémorisent et maîtrisent mentalement et physiquement les standards de travail (ordre des opérations, précautions, temps alloué, gestes ergonomiques).
- Mettre à jour la fiche de travail standard en cas d’améliorations nécessaires.
Le Kaizen n'est pas quelque chose qui se manifeste instantanément
Koshi IIYAMA
Le Kaizen n'est pas quelque chose qui se manifeste instantanément, même si vous sollicitez de le faire
Tout d'abord, il est essentiel de motiver tout le monde à participer, puis de leur enseigner les principes de l'amélioration. Ensuite, il faut partager des conseils et des méthodes efficaces pour y parvenir.
Enfin, l'enthousiasme et le dévouement d'un leader persévérant sont indispensables.

Pérennisation
Pour réussir durablement, il est préférable d’encourager les activités d'amélioration avec une approche sportive. Cela peut être amusant, on veut gagner, on ne veut pas perdre, c'est intéressant de faire des découvertes, plaisant de perfectionner ses compétences en résolution de problèmes, gratifiant d'être reconnu, tout le monde en profite, l'entreprise prospère, etc…
Canon Production System
Naissance et Clefs de la réussite Koshi IIYAMA
1. Introduction :
Au premier semestre 1975, Canon a subi une perte pour la première fois depuis sa cotation en bourse, due à la crise économique pétrolière et à l’échec de ses ventes de calculatrices. Canon s’est donc fixé d’une part, des objectifs d’urgence afin de redresser la société :
- Diminuer les activités dans le but de réduire les dépenses
- Rendre plus compétitifs les nouveaux produits tels que les appareils photos et les photocopieurs.
et d’autre part, Canon a étudié un projet d’entreprise d’excellence au niveau mondial.
Ce projet d’entreprise d’excellence était l’idée de Monsieur KAKU, ex-Président du conseil d’administration qui était à l’époque l’un des directeurs administratifs. Le projet consistait à révéler les points faibles de Canon, en effectuant une étude comparative des résultats similaires des meilleures entreprises mondiales de l’époque, et de les égaler ou de les dépasser. Canon a alors relevé le défi de devenir d’abord une entreprise d’excellence au Japon, puis au niveau mondial.
Afin de concrétiser cet objectif, Canon a déployé les méthodes suivantes :
- Création d’une nouvelle organisation répartie selon le type de production, et gérée comme une société indépendante.
- Etablissement de systèmes d’amélioration de l’organisation :
- Le système de Développement et de recherche Canon (C.D.S)
- Le système de Production Canon (C.P.S)
- Le système de Marketing Canon (C.M.S)
En conclusion, la réussite du CPS est due à la reconnaissance de la formation des managers de terrain, et à la réduction des niveaux hiérarchiques permettant à ceux-ci de travailler plus facilement. C’est grâce à cela que Canon, depuis cette époque et sur quelques années, a réalisé une augmentation de 30% environ de sa productivité.
2. La productivité
Quant à la méthode pour augmenter la productivité, il en existe deux. La première est la modernisation des machines et installations, l’autre est basée sur l’accroissement de l’efficacité du travail. Toutes les deux sont indispensables, et ne peuvent être négligées.
Canon, à l’époque, avait mis uniquement l’accent sur la modernisation alors qu’il existait aussi un retard dans le domaine des études relatives à l’augmentation de l’efficacité du travail. Autrement dit, les usines Canon n’étaient pas gérées de façon scientifique. Lorsqu’il a été mesuré la productivité de celles-ci, le constat de la performance générale fut de 50 à 60% pour les ateliers jusque-là estimés bons, et d’environ 30% seulement pour les autres. Canon a décidé alors l’implantation d’un système de gestion scientifique dans toutes ses usines, afin de rendre plus efficace le niveau de travail du personnel.
3. Formation des managers de terrain
Comme il est expliqué précédemment, le manager de terrain est l’homme clef dans l’évolution de l’efficacité du travail. Canon a donc procédé à la formation de ses managers de terrain, basée sur l’Industrial Engineering.
Canon organise quelques stages d’une durée de 60 heures continues, entre lesquels les stagiaires mettent en pratique sur leur propre ligne de production ce qu’ils ont appris. A la fin de cette formation répartie sur 3 mois, chaque participant expose son résultat obtenu devant ses supérieurs hiérarchiques.
Au cours de chaque stage, les managers de terrain étudient les méthodes d’analyse de la perte. Une fois l’atelier géré de façon scientifique, il leur est alors possible de quantifier clairement le travail utile et inutile. Les stagiaires peuvent ensuite non seulement réduire ce dernier, mais aussi valoriser davantage le travail utile dont on ignorait l’éventualité d’amélioration. Lorsque la personne a obtenu cette capacité d’amélioration, Canon estime qu’elle a acquis le Motion Mind.
4. Nécessité du Motion Mind
La chose vraiment essentielle dans l’Industrial Engineering, est le « Motion Mind » sur l’amélioration de la technique. Le Motion Mind est la connaissance profonde de l’étude et l’attitude analytique d’un geste. Si le leader détient le Motion Mind, il sera capable de découvrir au moins 4 ou 5 problèmes à chaque visite de son atelier. Si tous les managers de terrain acquièrent ce Motion Mind, alors nous serons en présence d’un énorme potentiel afin d’augmenter l’efficacité du travail.
Canon a acquis une certaine expérience dans ce domaine. En un an, Canon a doublé la productivité de fabrication des appareils photo AE-1, sans changer de ligne de production, sans modifier l’effectif et sans aucun investissement.
Cela n’a pas pu être réalisé sans efforts du manager de terrain qui, dans un esprit de « Motion Mind », observe le lieu de travail afin de découvrir les points d’amélioration, aussi minimes soient-ils. Ce travail est réalisable uniquement par celui-ci, toujours présent aux abords du lieu de production.
A propos du comportement de l’homme, A.H. MORGENSEN souligne les 3 tendances suivantes :
1-L’homme accepte difficilement le changement imposé par autrui.
2-L’homme se révolte contre l’innovation.
3-L’homme est contrarié par la critique.
MORGENSEN en conclut que, si un Industrial Engineer essaie d’améliorer le travail sans tenir compte de ces tendances, alors aucun projet n’aboutira.
5. Création d’un environnement adéquat au manager de terrain.
Le plus important dans la gestion d’une entreprise est l’augmentation de la compétence du manager de terrain, qui doit être le principal acteur dans l’amélioration de la productivité. L’obtention de ceci ne sera possible qu’avec la création d’un environnement adéquat. Pour cela la définition du rôle du manager de terrain et une sensibilisation à celui-ci des autres personnes de l’entreprise sont nécessaires. En effet, il s’agit de créer un climat favorable afin de poursuivre dans les meilleures conditions possibles l’amélioration de l’efficacité.
Il existait sept ou huit niveaux hiérarchiques dans les sociétés de moyenne et grande importance, y compris Canon, alors qu’il n’en suffisait que de 4 ou 5. Il n’y a aucun intérêt à en avoir plus. A cause de ces nombreuses étapes hiérarchiques règne une mauvaise circulation des informations. Plus le nombre de niveaux est important, plus le nombre de managers augmente (de 4 à 5 fois plus). Cette augmentation a une conséquence plus grave : la modification du rôle du manager à celui d’un simple exécutant.
En effet lorsqu’une personne a l’intention d’effectuer quelque chose, elle a besoin d’obtenir l’accord de la hiérarchie supérieure. Celle-ci composée de nombreux niveaux rend le retour de l’information lent et difficile, et a pour effet de démotiver le demandeur. La multiplication des niveaux provoque aussi un empiètement des devoirs. La réduction des niveaux hiérarchiques à quatre, donne une vision plus claire du rôle de chacun.
L’étendue du travail du manager de terrain par exemple, doit être équivalente à la somme de travail du manager de 3 hiérarchies (Chef adjoint, chef de bloc et leader). Comment se fait-il que le manager de terrain puisse exécuter le travail de ces personnes ? C’est tout à fait le contraire, c’est parce qu’il y a plus de monde que le travail devient plus lourd. Le travail qu’une personne seule peut facilement accomplir devient vite chargé et difficile lorsqu’il y a trop de personnes à l’exécuter.
Bien qu’il y ait des raisons historiques à ces 7 ou 8 étapes hiérarchiques, il est vrai que leur réduction à 4 ou 5 est possible. Canon a donc effectué parallèlement, une formation des manager de terrain et une diminution des niveaux hiérarchiques de 8 à 5.
6. Le manager de terrain.
Le terme utilisé chez Canon pour cette personne est le Superviseur, car Canon ne voulait pas d’un titre reflétant une idée préconçue du travail.
Il n’est pas possible pour une personne seule de gérer une entreprise. Le PDG, quelle que soit sa compétence, ne peut pas augmenter la productivité en dirigeant directement chaque opérateur. Cependant, le manager de terrain, lui, a la possibilité de le faire. Par conséquent, ceci est bien le travail du manager de terrain.
L’efficacité de travail ne peut augmenter que sur l’initiative d’une personne ayant de la bonne volonté. C’est pourquoi, une société est gérée par une équipe de nombreux managers. Chacun d’eux a sa propre imputabilité de la gestion que les autres ne peuvent pas assumer. La croissance de l’efficacité du travail est sous la responsabilité du superviseur. Voilà pourquoi Canon considère le superviseur comme un manager de terrain.
Le manager est responsable de la rentabilité de la même façon que le PDG. Il doit veiller au développement de la société et à l’augmentation du bénéfice, le manager de terrain doit pouvoir améliorer la productivité de travail de sa ligne de production. Il incombe donc à tous les managers d’accroître le niveau de leur équipe. Chaque superviseur est responsable de l’augmentation de l’efficacité de travail, et doit parvenir à l’objectif qui lui est demandé.
Le manager réalise aussi sa gestion en s’appuyant sur autant de personnes que possibles. Un manager qui ne délègue à personne est un mauvais manager. Déléguer à quelqu’un signifie se servir de ses subordonnés ainsi que de ses supérieurs. La tâche des superviseurs est de rendre facile le travail de leurs subalternes.
7. La gestion par objectif
Lorsque les managers de terrain acquièrent le Motion Mind et leur environnement de travail adéquat, il reste au directeur d’usine, à communiquer aux directeurs, son objectif, dérivé de la nécessité de gestion de la société. C’est à partir de celui-ci que chaque directeur établit avec précision son objectif propre. En effet l’objectif initial du directeur d’usine est réparti avec précision selon toute la hiérarchie et ce, jusqu’aux managers de terrain. Cette application s’appelle la gestion par objectif.
Chez Canon, les indicateurs de l’objectif annuel sont établis au début de l’année et une fois par mois, au niveau de la direction et des services, est analysée et solutionnée la différence entre la réalité et l’objectif, si elle existe. Cette réunion est appelée la réunion du comité CPS.
8. Conclusion
La clef de l’augmentation de la productivité est de positionner le manager de terrain au centre des activités d’amélioration. La réalisation de cela s’effectue en suivant les étapes ci-dessous :
- Formation des managers de terrain afin de leur permettre l’acquisition du Motion Mind.
- Réduction du nombre de niveaux hiérarchiques afin de faciliter le développement des capacités de management des managers de terrain.
- Application de la gestion par objectif, y compris pour les managers de terrain.
Si les managers de terrain réussissent à posséder de telles capacités, alors il sera possible d’accroître la productivité d’une façon importante sans grand investissement dans l’équipement.
Koshi IIYAMA
Ex-Responsable du Canon Production Système
©K.L.C. Koshi Lean Consulting SASU.
Société à associé unique. Tous droits réservés.
Siège social : 18 Allée Auguste Renoir 35340 Liffré, France, R.C.S. Rennes 918142845
N°TVA FR 57918142845 - SIRET 91814284500018 - NAF 7022 Z
Tel : + 33 (0) 614070022 - E-mail: contact@koshi-lean-consulting.fr
Hébergeur : IONOS SARL
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.
